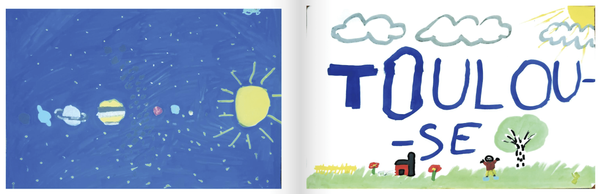À Pourgues, « on fait la paix avec l’argent »

Salut ! Je suis Martin et j’ai la chance de réaliser un service civique avec Les Chemins de la Transition et la Coopérative Oasis sur le chemin des écolieux à vélo. Je termine mes études d’ingénierie au cours desquelles j’ai pu découvrir et explorer le mouvement low-tech qui m’inspire beaucoup, notamment autour des questions d’autonomie et d’organisations sociales. C’est dans cette dynamique que j’ai voulu participer à cette expérience autour des écolieux qui s’annonce très inspirante.
Le début de cette aventure m’a mené au village de Pourgues, où j’ai passé 3 semaines en immersion. J’ai été très impressionné par les relations avec les enfants, les outils de gouvernance mis en œuvre, l’accueil de personnes extérieures et les choix de structuration. Avec Jade, qui réalise le même service civique que moi, nous avons trouvé pertinent d’explorer la dimension économique au sein du lieu. Merci aux habitants et habitantes Yohan, Martine, Guillaume et Ramïn qui nous ont accordé du temps pour répondre à nos questions.

La liberté d’être soi
Le projet de l’écovillage de Pourgues est inspiré des écoles démocratiques. Ces lieux d’enseignement alternatif sont caractérisés par la liberté laissée aux enfants de choisir ce qu’ils veulent faire, tant que cela ne transgresse pas la liberté d’une autre personne. De plus, ces écoles fonctionnent par démocratie directe, en donnant le pouvoir aux enfants de décider de leurs règles et du cadre. Mais pourquoi ne pas aller plus loin en appliquant ces idées à une communauté, à un lieu de vie ? Ce questionnement est apparu comme une graine dans la tête de plusieurs personnes investies dans l’École Dynamique de Paris et a germé sous la forme de l’écovillage de Pourgues. Après 7 ans d’expérimentations, le collectif a aujourd’hui des outils solides de structuration pour le vivre-ensemble et pour leur organisation, notamment en terme de gestion économique où ils sont actuellement en train de passer un cap.
Comme écrit dans l’entrée, « libre d’être soi, ensemble » est le principe central du collectif. L’idée étant d’entretenir un espace où chaque personne peut s’épanouir individuellement et donc ensuite collectivement. Dans la pratique, cela veut dire qu’une partie du temps de chacun et chacune est allouée au bon fonctionnement du village (réunion d’organisation, accueil, cuisine, tâches ménagères, entretien…) et une autre sert à prendre du temps pour soi et faire vivre des projets personnels. En effet, les membres du village ont de l’argent de côté ou développent une activité rémunératrice, intérieure ou extérieure à Pourgues. Ainsi, une certaine autonomie financière est entretenue par chaque personne, ce qui permet de ne pas dépendre des activités de Pourgues pour répondre à l’ensemble de ses besoins. Les villageois et villageoises versent chaque mois un montant fixe à Pourgues comprenant toutes les choses qui sont mutualisées sur le lieu (charges, nourriture, entretien des espaces communs…). Pour Martine, cette organisation claire et structurée est très rassurante. « On sait où on va ». Elle donne l’exemple du processus d’intégration pour devenir villageoise, qu’elle termine tout juste. Il y a d’abord le premier contact avec l’écovillage d’une semaine minimum, puis, si c’est bon pour tout le monde, le mois en immersion qui peut déboucher sur l’année d’intégration. Pour chaque personne habitante, il est exigé qu’elle ait acheté des parts de Pourgues et qu’elle verse un apport mensuel au collectif.

Trouver l’équilibre économique
Au cours de la construction du fonctionnement du village qui a mené à la gestion financière actuelle, Yohan estime que « on a fait la paix avec l’argent ». Pourgues n’est pas dans une dynamique « jusqu’au-boutiste » en terme d’autonomie et de sobriété. Un confort de vie important est assumé et l’écovillage n’est pas autonome sur tous les points. Cela implique de recourir à l’argent pour interagir avec l’extérieur et assurer le fonctionnement du village. Guillaume partage son sentiment que, dans beaucoup de projets, il y a une peur de l’argent, qui est vu comme « sale ». Guillaume y voit juste un « nouveau système de troc ». Au début du projet, Ramïn explique que Pourgues fonctionnait beaucoup sur le fait que tout le monde donne de son temps. Mais au bout d’un moment, le fait de travailler gratuitement pour le collectif n’a plus convenu à certaines personnes. En ayant conscience des dérives capitalistes que la monnaie unique peut générer, l’argent leur permet de visibiliser et de valoriser certaines tâches en interne. Un membre du collectif a par exemple de grosses compétences pour les chantiers d’entretien et de rénovation du village. Ce travail représente beaucoup de temps et d’énergie sur des courtes périodes et il paraît évident pour le collectif de ne pas juste lui demander une contribution mensuelle plus faible en échange, mais bien de le rémunérer pour son travail. Cela permet à Pourgues de faire valoir les compétences en interne tout en assurant une indépendance financière aux habitantes et habitants du village. Pour Guillaume, il y a malheureusement encore un conditionnement par l’adage « tout travail mérite salaire » et il sent un besoin que les membres du collectif voient passer l’argent pour prendre conscience des tâches réalisées. Il m’explique que ça lui paraît compliqué de généraliser le troc, d’autant plus à Pourgues où des compétences importantes en termes de relations humaines, thérapies et soin sont emmagasinées, difficilement valorisable sous la forme du troc. Difficile mais pas impossible. Guillaume me raconte qu’une personne est venue faire une formation à Pourgues, normalement très coûteuse, en échange d’un cercle restauratif pour le collectif de cette personne, processus visant à apporter du soutien dans la gestion de leurs conflits.

Les séjours immersifs, pillier du modèle économique
À côté des activités individuelles, la vie du collectif est importante, avec des espaces communs qui sont très utilisés pour la cuisine et les repas collectifs, les temps de jeu avec adultes et/ou enfants, les réunions, les discussions informelles… Il y a aussi une activité qui mobilise l’ensemble du collectif : les séjours immersifs. Durant les périodes des vacances scolaires (hors hiver), des personnes souhaitant découvrir la vie de Pourgues viennent pour une semaine thématique par groupe allant d’une dizaine à une trentaine. Ces périodes amènent beaucoup d’animation et requièrent un investissement important de l’ensemble du village. Elles permettent d’inspirer autour des valeurs et des pratiques tout en faisant vivre le lieu puisque cela permet de récolter un tiers du chiffre d’affaires de l’écovillage, les deux autres tiers venant des apports mensuels des membres du village. Ces semaines d’accueil représentent un certain coût donc il est aussi proposé à des personnes extérieures de venir en « séjour solidaire » sur plusieurs semaines tout en contribuant aux activités de Pourgues. Cela permet une grosse réduction sur le prix de la venue. Cela veut dire qu’on contribue et qu’on paye ? Guillaume m’explique que c’est similaire aux personnes qui y habitent, il y a une participation financière bien qu’il y ait aussi des tâches à réaliser pour le collectif. Sans cette contribution, la charge financière est portée par les villageois et villageoises, qui leur accorde déjà un certain temps.

La transparence est capitale
Pour vivre à Pourgues, il est nécessaire d’acheter des parts du lieu (30 000 € minimum) et de contribuer mensuellement aux charges (en moyenne 500 €). Pour habiter un espace du collectif (chambre, tiny-house, dôme…), un investissement supplémentaire est réalisé, pouvant aller de 10 000 € à 80 000 € selon le besoin de confort. Certaines personnes habitent aussi leur propre caravane ou camping-car. Au total, cela représente une charge financière qui n’est pas accessible pour toute personne. « Ce n’est pas inclusif mais nécessaire » (Yohan). « Il faut être soudé pour la tribu » (Martine). Le lieu a été acheté pour un million d’euros et il y a aujourd’hui des personnes largement majoritaires dans l’investissement du lieu. Pour rééquilibrer la responsabilité, le collectif souhaite que chaque personne achète des parts du lieu. Il y a aussi le souhait de mettre de l’argent de côté chaque année pour rembourser les personnes ayant investi et diminuer le prix du lieu. Du côté des apports mensuels, une grande diversité existe aujourd’hui. Cette contribution était libre au début du projet mais ce fonctionnement ne suffit aujourd’hui plus à payer les dépenses de Pourgues. Pour avancer sur cet aspect, un travail individuel et collectif est en cours sur le rapport à l’argent.
Au sein de l’écovillage, la transparence est au cœur des relations humaines. « Pas de tabou, pas de malaise » souligne Guillaume. Et en ce moment, les villageois et villageoises se sont décidés à rendre tous les capitaux, entrées et héritages financiers transparents entre elles et eux. Cela correspond à une énorme marche car le rapport de chaque personne à l’argent varie beaucoup, dans un pays où ce sujet est particulièrement tabou. En particulier, cela amène à se demander : qu’ai-je à cacher ? Et pourquoi ? Ce processus, inspiré des travaux de Peter Koenig, est passé par un tour de partage sur son rapport à l’argent et à l’héritage, les tensions que cela peut amener, son expérience, sa situation socio-économique… Individuellement, chaque personne a ensuite fourni toutes les données numériques associées, pour enfin les présenter aux autres en racontant le récit humain correspondant à ces chiffres. C’est un processus émotionnellement très éprouvant qui peut permettre à Pourgues de gravir une grande marche dans la force du collectif. Cela a notamment pour ambition de permettre de contribuer financièrement en conscience, de gérer l’argent « comme si nous étions une sorte de grande famille » (Ramïn).

En arrivant à Pourgues, j’avais des questionnements sur le modèle économique et les choix financiers, notamment quand une contribution financière m’avait été demandée alors que j’aurais imaginé que mettre la main à la pâte justifiait le gîte et le couvert. Les échanges avec les membres du collectif et la vie dans le lieu m’ont permis de mieux comprendre la dynamique globale dans laquelle s’intégrait ces choix. J’ai aussi été vraiment impressionné par la transparence des interactions. Cela m’a paru très puissant et cela le sera d’autant plus en l’appliquant aux capitaux.