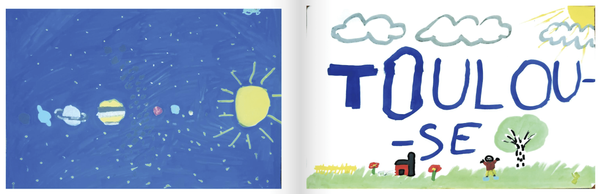Dans les rouages d'une ressourcerie : collecte, traçabilité, tri, valorisation....
Si tu veux découvrir comment fonctionne une ressourcerie, cet article est fait pour toi !
Il s’appuie sur une expérience vécue à la ressourcerie des Fourmis Vertes, à Landisacq, dans l’Orne. Même si chaque ressourcerie a son propre mode de fonctionnement, cet article te permettra de comprendre les principales étapes, de la réception des dons jusqu’à leur mise en vente. Tu pourras ainsi te familiariser avec toutes les facettes de la gestion et des activités des ressourceries.
A savoir que les ressourceries sont à l’intersection entre l’économie sociale et solidaire et l’économie circulaire. Elles ont 4 principales missions : la collecte, la valorisation, la vente et la sensibilisation. Ici, je vous présenterais comment les ressourceries répondent à ces missions.
1- Réception des biens par différents moyens
Les « dons » sont collectés de plusieurs façons :
Dons de particuliers Les particuliers apportent leurs dons directement à l’association ou dans les points de collecte des déchetteries alentour.
L’association peut se déplacer pour les dons les plus volumineux ou pour effectuer des vide-maisons (services payants).
Pour des questions de sécurité, de logistique ou de manque de débouchés certains produits ne sont pas acceptés lors de la collecte (exemples non exhaustifs : casque de vélo, siège auto ; imprimantes, frigo ; télévision cathodique).
Dons de professionnels Avec la mise en œuvre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) en France, les entreprises sont incitées à privilégier le réemploi, la réutilisation et le recyclage. Faire des dons aux ressourceries leur permet de respecter ces obligations légales tout en valorisant leurs surplus. Les professionnels, notamment ceux du commerce ou de la production, se retrouvent souvent avec des invendus, des matériaux inutilisés ou du mobilier usagé. En les confiant à des ressourceries, ils réduisent les coûts liés à la destruction ou au stockage, peuvent bénéficier de déductions fiscales, et renforcent leur image de marque. Dans ce contexte, les professionnels ont beaucoup à y gagner.
Cependant, certains bénévoles et salariés de ressourceries rapportent avoir parfois accepté des dons qui n’ont pas pu être correctement revalorisés ou qui ont engendré des coûts de traitement disproportionnés. Cela les rend aujourd’hui plus vigilants quant aux dons reçus. Une sélection des dons professionnels est donc nécessaire en amont pour garantir que les objets collectés soient en bon état ou réutilisables.
Donner, oui, mais pas n'importe quoi. Les « dons » que ce soit de professionnels ou de particuliers peuvent parfois s’apparenter à des cadeaux empoisonnés. En effet, dans ce qui est donné, une part des biens n’est pas réutilisable et doit être renvoyé dans le circuit conventionnel de gestion des déchets*. Plus cette proportion est grande, plus l’association perd du temps à trier les dons pour finalement ne revaloriser qu’une infime partie, tout en portant la responsabilité de jeter ce qui n’est pas récupérable.
Ainsi, si vous voulez réellement faire une bonne action, prenez le temps de trier vos biens avant de les donner. Les ressourceries ne sont pas des déchetteries. Si vous n’achèteriez pas un produit parce qu'il est trop abîmé, sans doute que personne ne le fera. Dans ce cas, mieux vaut l’apporter directement à un centre de tri pour une gestion adaptée.
Il y a ici un enjeu de sensibilisation du public : Donner oui mais pas n’importe quoi.
2- Pesée et traçabilité des biens réceptionnés
Une fois les biens réceptionnés, ils sont pesés et tracés. La pesée permet d'identifier le poids annuel de « dons » et quelle part est revalorisée. Le traçage permet d'identifier les articles par type de produit.
3- Tri des biens
Le tri permet de distinguer les biens pouvant être directement réemployés ou valorisés de ceux qui ne le peuvent pas et qui seront « jetés » c'est-à-dire réintégrés dans le circuit conventionnel de gestion des déchets*.
D'une ressourcerie à l'autre, la méthode de tri varie. Dans certaines d'entre elles, l'ensemble des produits sont vendus “en l'état” c'est-à-dire qu'ils ne font pas l'objet d'un test ou de réparation si besoin, laissant au consommateur la responsabilité de “prendre le risque” d'acheter un produit qui ne fonctionnera pas. Dans ces ressourceries il n'y a pas de travail de valorisation.
Aux Fourmis, les produits électroniques et électroménagers sont testés avant d'être mis en vente. Bien que cela nécessite davantage de maintenance, cela permet d’éviter aux clients d'avoir de mauvaises surprises. Les réparations sont réalisées de manière ponctuelle, car elles sont très consommatrices de temps et de matériaux.
*Une petite partie sera recyclée, mais la majorité sera incinérée ou enfouie.
4- Valorisation : réparation et récupération de pièces
Le réemploi direct est la base du système économique des ressourceries, les autres formes de valorisation sont marginales, car trop coûteuses.
Les bénévoles nécessaires à une meilleure revalorisation : l'exemple des vélos. Aux Fourmis, un exemple de valorisation concerne les vélos. Ceux qui peuvent être réparés sont remis en état et revendus, tandis que ceux qui ne sont pas réparables sont démontés pour récupérer des pièces détachées. La majorité de la réparation se fait à partir de pièces que l’équipe des Fourmis a récupérées au préalable. Acheter des pièces neuves coûterait trop cher et pose des questions éthiques : D'où vient ce produit neuf ? Comment a-t-il été produit ?
Ces activités de revalorisation sont principalement assurées par des bénévoles ayant une expertise spécifique dans ce domaine. Les salariés, quant à eux, n’interviennent pas à cette étape, car elle est trop chronophage et peu rentable économiquement. On pourrait imaginer que si les étapes de revalorisation étaient davantage subventionnées, elles deviendraient plus pérennes.
Morgane, directrice de la Ressourcerie, souligne qu'à l’heure actuelle, peu de structures ont les moyens de s’investir pleinement dans la revalorisation par la réparation. Seul le réseau ENVIE qui regroupe près de 50 entreprises d'insertion peut se le permettre car de par sa taille, il faut des économies d'échelle. Des ressourceries plus petites comme celles des Fourmis ne peuvent pas se le permettre.
Des tests trop coûteux : l'exemple des appareils photo argentiques. À la ressourcerie des Fourmis Vertes, l'un des salariés pourrait théoriquement remettre certains appareils photo en circulation du fait de ses connaissances techniques dans le domaine. Cependant, cette démarche demande beaucoup (trop) d'investissements. Tester les anciens appareils photo nécessite l'achat de piles et pellicules compatibles, souvent difficiles à trouver. Il faut ensuite prendre des photos et les faire développer, ce qui engendre des coûts supplémentaires. Chaque étape demande également du temps : évaluer les besoins, acheter le matériel, réaliser les tests, faire le tri entre ce qui est utilisable ou non. Même si tous les appareils fonctionnaient, il n'est pas certain que cette opération soit rentable, surtout avec la perte inévitable.
5- Préparation à la vente
Une fois triés, les produits qui peuvent être vendus sont étiquetés et mis en rayon.
Aux Fourmis certain·es bénévoles prennent du temps pour mettre en valeur les produits en vente. Si l'objectif n'est pas de ressembler à un Ikea, ranger les pots par couleur, faire des mises en scène avec le service vaisselle permet aux clients de mieux s'orienter dans le magasin, et de voir le « potentiel » de certains produits.
6 - Étapes de la vente
- Vente en boutique
- Vente au kilo : Les articles qui ne se vendent pas en boutique sont proposés lors de ventes au kilo.
- Gratiferia : Les produits invendus lors des ventes au kilo sont ensuite mis gratuitement à disposition du public.
Grâce à ces différentes étapes du don à la vente, la ressourcerie des Fourmis réemploie 120 tonnes parmi les 170 tonnes de dons reçus. C'est un taux de réemploi relativement élevé.
7- Sensibilisation
Les Fourmis organisent régulièrement des actions de sensibilisation autour du réemploi, de la low-tech et d'autres thématiques liées à l'économie circulaire. Par exemple, lors de ma visite, se tenait une journée dédiée à la low-tech, comprenant des ateliers ludiques et collaboratifs tels que des fresques, des ateliers de cuisine ou de lactofermentation, ainsi que des conférences interactives.
Au-delà de ces événements ponctuels, les ressourceries s’emploient à rappeler en permanence l’importance d’une consommation raisonnable et raisonnée. Cela se traduit, par exemple, par des affichages éducatifs (voir méthode bisou) au sein même de la ressourcerie pour inciter les client·es à adopter des pratiques durables au quotidien.