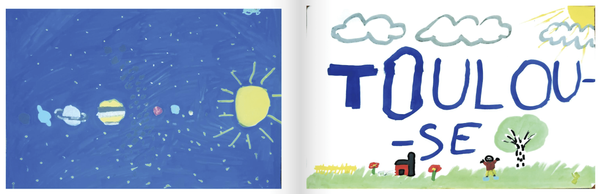8/10 - Et si les musées avaient tout à voir avec la démarche low-tech ?

Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande, Notre-Dame-de-Bliquetuit, 76 : Préservation du patrimoine naturel, culturel et paysager

Et si les musées avaient tout à voir avec la démarche low-tech ?
Un musée selon Wikipédia est "un lieu dans lequel sont collectés, conservés et exposés des objets, des œuvres d'art, ou un patrimoine immatériel, dans un souci d’enseignement et de culture." Jusqu'ici, on est d'accord. Mais serait-il possible de trouver de nouveaux rôles aux 10 000 musées et lieux d'expositions en France dans le contexte actuel ?
Au Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande, l'équipe est persuadée qu'un musée a toute sa place pour nous aider à imaginer de nouveaux modes de vie plus soutenables et durables.
Je vous explique !
L'Ethnotèque, c'est le nom du musée géré par le parc au bord de la Seine entre le Havre et Rouen. Mais qu'a t’il de si "différent" ce musée pour en faire un article dans un voyage sur la démarche low-tech ?
Premièrement, c'est un musée qui ne se visite pas, mais qui vient rencontrer notre curiosité via des expositions itinérantes sur le territoire du parc.
Deuxièmement, il conserve des objets et témoignages de la vie domestique, de l’artisanat, de l’industrie et de l’agriculture Normands depuis la fin du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe.
Petit rappel historique :
- Les énergies fossiles, en particulier pétrole et charbon, connaissent un essor fou vers la fin du XIXe, mais tout cela reste dérisoire par rapport à l'état actuel de leurs utilisations. Autrement dit, l'Ethnotèque propose une photo d'un temps où l'énergie "facile" était à ses débuts, et où il fallait encore faire avec des ressources locales et vraiment renouvelables.
C'est avec ce regard sur le musée que le parc construit des ateliers et des stages de découvertes de gestes et de savoir-faire anciens pouvant avoir un écho avec une nouvelle manière d'habiter le territoire. J'ai eu la chance de travailler avec cette superbe équipe pendant 2 semaines pour imaginer quels pourraient être les savoirs et savoir-faire à partager autour des arbres trognes.
( Je vous rassure, moi non plus je ne connaissais pas en arrivant, et maintenant, je ne parle plus que de ça !! )
Ne vous êtes-vous jamais demandé s' il n'était pas possible de "récolter" du bois sans abattre un arbre, tout comme on récolte des fruits qui poussent chaque année ?
Imaginez que vous coupiez un jeune arbre à votre hauteur.
Pour faire simple, un poteau avec des racines.
L'arbre va repousser à l'endroit où vous l'avez coupé, en faisant un grand nombre de petits rejets, comme des doigts sur une main. Mais vous ne lâchez rien et après quelque temps, vous coupez de nouveau ces rejets au même endroit que la fois précédente.( Si l'arbre est un saule, vous voici avec des brins d'osier !)
Notre jeune arbre, aussi motivé que vous, décide alors de faire grossir son tronc et n'abandonne pas son projet de rejets, en repartant toujours du même endroit. Cette fois-ci, vous allez décider de le laisser tranquille pour un petit moment, 8 ans en moyenne en fonction des essences. Et ensuite ? On prend les mêmes et on recommence ! Vous coupez les rejets qui sont aujourd'hui de belles branches, perchées à votre hauteur sur un tronc bien plus gros que ses congénères. Et c'est reparti pour 8 ans. Le tronc va encore grossir, réduisant années après années le risque que l'arbre ne se déracine. Il va aussi se creuser, créant un lieu de vie magnifique pour un nombre incalculable d'espèces. Quant à vous, vous obtenez du bois d'œuvre, du bois de chauffage ou du fourrage pour les animaux grâce au grand nombre de feuilles et de fruits.
Il s'agit là d'un véritable pacte entre homme et biodiversité qui permet de gérer une ressource en bois de manière "vraiment" durable !
Les branches que vous coupez sont remplacées toutes seules, et en plus grand nombre. Si le bois est brûlé de manière efficace, avec un poêle de masse par exemple, alors on en récupère la quasi-totalité de son énergie sous forme de chaleur, et le CO2 émis sera capté par les nouvelles branches déjà en train de pousser. Cela implique de savoir couper son bois, monter un bûcher et le faire sécher, connaître les différents moyens de chauffage au bois mais aussi s'inspirer d'un ancien temps où l'on chauffait les personnes (avec des bouillottes par exemple) plutôt que les espaces. On cherchait le confort thermique, et non la température ambiante, par manque d'énergie pour le faire.
Voici un échantillon des thématiques qui seront abordées lors d'ateliers au Parc sur l'année 2025 pour repenser la place de l'arbre têtard sur le territoire.
Oui, j'ai bien dit repenser car cette méthode de coupe est pratiquée depuis des centaines d'années et s'est perdue en France au cours du XXe siècle. Les trognes faisaient partie intégrante de nos territoires bocagers, composés de haies et de taillis, permettant de s'abriter du vent, faire de l'ombre ou encore produire bois et nourriture.
Une trogne, ou arbre têtard, est donc un arbre qui collecte des ressources variées pour son écosystème, qui conserve des éléments essentiels comme le carbone et qui expose dans ses creux des espèces rares et fragiles, telles des œuvres d'arts bien à l'abri. Il représente enfin un patrimoine immatériel pour nos paysages et il est doté d'une importante longévité permettant de voir se transmettre les savoirs, savoir-faire et histoires qui lui sont prêtées.
Selon la définition de Wikipédia, il semblerait bien que l'arbre têtard puisse lui aussi être considéré comme un musée ! =-)La boucle est bouclée !
Et visiblement, cela n'avait pas échappé à l'équipe de l'Ethnotèque, ambassadrice d'une démarche low-tech on ne peut plus culturelle.
C'était la conclusion,
au fil de l'eau de la seine et des veines du bois.