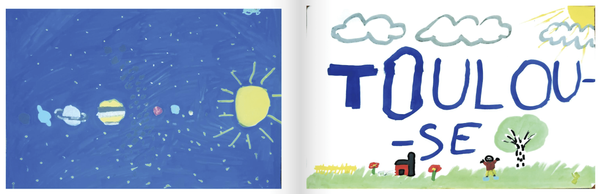Immersion au sein du 38e Festival international du voyage à vélo au Mans
Une après-midi au festival du voyage à vélo
De retour chez moi pour le week-end, les membres de ma famille m'annoncent qu'ils seront de sortie au festival du voyage à vélo le lendemain. L'idée m'intrigue. Sans trop hésiter, je décide de les accompagner.
Le Mans. 12h08. Il pleut lorsque j’arrive devant le Palais des congrès du Mans où se tient le festival. Après trois appels restés sans réponse, mon téléphone me renvoie inlassablement sur le répondeur de ma mère. Résignée, je me décide à entrer dans le bâtiment. Rapidement, un détail me frappe : le public. Si toutes les générations sont présentes, les personnes âgées sont largement majoritaires. Peut-être parce qu’elles ont le temps, qu’elles se sont laissées attirer par les affiches du festival, ou que cela réveille en elles des souvenirs de jeunesse… Après tout, écouter un récit d’aventure, c’est déjà partir un peu. Je m'empare du programme du festival. Quelles aventures vais-je découvrir aujourd’hui ? Si je suis seule, autant savoir ce qui m'attend.
Mes yeux parcourent la feuille. Rapidement, je repère quelques activités intéressantes : Échange – Je fais voyager mon handicap à vélo. D’autres piquent ma curiosité : Projection – Canovélo, à la recherche de l’instant parfait ou l’histoire d’une traversée de la France quand on n’arrive pas à choisir entre canoë et vélo de Paul Villecourt.
Je suis encore plongée dans le programme lorsqu’une voix familière m’interpelle. Ma mère. Elle me rejoint avec enthousiasme et m'explique qu'elle sort d'un atelier “super instructif” sur la préparation du vélo avant le départ. Maintenant, elle se dirige vers un autre atelier : "Que mets-tu dans tes sacoches ?" Je décide de la suivre.
Préparer son vélo pour l’aventure
Dans la salle, les chaises sont disposées en arc de cercle autour d'une table où repose un vélo chargé. La salle est pleine. Une femme prend la parole et présente l'association organisatrice de l’évènement : Cyclo-Camping International. Fondée en 1982, elle favorise l'échange d'expériences autour du voyage à vélo. Bien qu'à vocation internationale, elle est particulièrement active en France.
Trois intervenant·es partagent ensuite leurs expériences : Malou*, une trentenaire qui, après quelques voyages à vélo de courte durée, est partie un an jusqu'en Mongolie avec son compagnon ; Aude*, une jeune femme qui planifie son voyage vers Oslo après une première expérience aux Pays-Bas l’été dernier ; et Alain*, un retraité qui a fait toutes sortes de voyages à vélo. [*Prénoms modifiés]
Chacun·e expose ses choix, son expérience, ses conseils sur le matériel à emporter. Malou et son compagnon avaient un chargement conséquent pour tenir un an sans renoncer au confort : quatre sacoches, deux à l'avant, deux à l'arrière, et un sac supplémentaire sur le porte-bagage, pour un total dépassant les 35 kg chacun·e. Aude voyage plus léger, tout en conservant quatre sacoches, un bon compromis entre praticité et autonomie. Quant à Alain, avec l'expérience, il est passé de quatre à deux sacoches qu’il a conçues lui-même pour les rendre plus légères. Il dit privilégier le confort sur le vélo plutôt que pendant le bivouac.
L'échange est riche, ponctué d'astuces et de récits. Il n’y a pas de vérités, pas de bonnes ou de mauvaises pratiques, les besoins des un·es ne sont pas ceux des autres. Cet atelier était l’occasion de se rappeler que les voyages diffèrent, tout comme les voyageur·ses.
Voyager au féminin : Défis, astuces et liberté sur deux roues
Après un déjeuner bien mérité, un autre atelier attire mon attention : une table ronde sur le voyage au féminin. Après une erreur de salle, j’arrive enfin. J’ai manqué quelques minutes, sans doute celles de présentation des cinq intervenantes. La salle est presque pleine, il reste quelques places, mais difficilement accessibles. Je pose mon sac et me tient debout. Sans grande surprise, le public est majoritairement féminin.
L'un des premiers sujets abordés concerne la mécanique. Comment s'en sortir lorsqu'on n'a aucune base en réparation, surtout quand, en tant que femme, on n’a pas été socialisée à la bricole ? Plusieurs réponses : se former avant de partir, apprendre sur le tas ou simplement compter sur les rencontres. L’une des intervenantes raconte avoir pris les devants en s’inscrivant à une formation avant son départ. Alors qu'elle pensait apprendre à remplacer un pneu, la formation portait sur des parties du vélo dont elle ignorait le nom, annonçant que le caractère débutant de la formation ne l'était peut-être pas tant. Dans l’assemblée, une personne rebondit et rappelle que de plus en plus d’associations proposent des ateliers de réparation en non-mixité choisie. Ces espaces permettent un apprentissage sans pression, sans qu'on présuppose une connaissance minimale, contrairement aux formations souvent pensées par et pour des hommes, qui, de par leur socialisation genrée, ont généralement été plus exposés à la mécanique. Une autre intervenante confie ne pas être à l’aise avec la mécanique du vélo, mais que cela ne lui a jamais vraiment posé problème en voyage. Elle plaisante : « Je n’ai pas confiance en mes compétences en réparation, mais j’ai confiance en ma tchatche pour trouver quelqu’un qui pourra m’aider ! » Globalement, les intervenantes expliquent avoir appris sur le tas et toujours su se débrouiller. L’une d’elles relativise : même à plat, un vélo roule ; il va moins vite, mais il avance, et c’est le principal.
Puis, la discussion dévie sur la question du lieu où passer la nuit. Dormir chez l’habitant·e est rapidement évoqué. Pour l’une des intervenantes, c’était central : bien plus que le vélo en lui-même, son voyage était avant tout un prétexte à la rencontre humaine, au partage d’expériences et aux récits de vie. Sur 180 jours de voyage, elle en a passé 140 chez des inconnu·es. Une autre voyageuse explique qu’elle l’a beaucoup pratiqué, mais qu’elle le fait de moins en moins. Aller chez l’habitant·e implique de partager des moments, d’échanger, et parfois, après une longue journée de vélo, on n’aspire qu’à se reposer. De plus, si l’on est accueilli·e chaque soir, on finit par raconter la même histoire encore et encore. L’hébergement chez l’habitant·e demande aussi une certaine organisation : il faut contacter ses hôtes à l’avance, ce qui limite la flexibilité et laisse peu de place aux imprévus.
Pour les plus aventureuses ou les solitaires, le bivouac est une bonne option. Mais où planter sa tente ? Certaines préfèrent la solitude en pleine nature, tandis que d’autres se sentent plus en sécurité en restant proches des habitations. Les conseils de lieux fusent : les stades, souvent déserts en été, peuvent offrir un abri et parfois des douches ; les cimetières, eux, garantissent un accès à l’eau et un calme absolu.
Vient la question des menstruations en voyage. Parmi les cinq intervenantes présentes, aucune n’avait véritablement ses règles sur la route : ménopause, hormonothérapie, absence de règles du fait d’un stérilet hormonal. La seule pouvant potentiellement les avoir explique qu’elle prend sa pilule en continu lorsqu’elle voyage, afin d’en éviter les potentiels désagréments. Elle précise toutefois que cela reste une solution ponctuelle et que, dans le cadre d’un voyage au long cours, la question mériterait réflexion. Dans l’assemblée, plusieurs personnes prennent aussi la parole pour partager leurs expériences. Les serviettes jetables ou lavables posent toutes le même problème : les points de pression et de frottement avec la selle. La culotte menstruelle est évoquée comme bonne alternative, mais soulève la question du nettoyage et du séchage, plus difficile en voyage. La cup est finalement la solution la plus plébiscitée, bien qu’elle présente un inconvénient lorsque l’accès à une eau propre et potable est limité, notamment dans certains pays.
Ensuite, un autre sujet tout aussi essentiel a été abordé : les besoins naturels en voyage. Si certaines ne sont pas gênées à l’idée de se mettre accroupies, les fesses à l’air, peu importe l’endroit ou la météo, l’une des intervenantes souligne l’importance du “pisse-debout”, devenu un outil indispensable pour elle. Bien qu’elle ait longtemps fait sans, elle note que cet accessoire a été particulièrement utile lorsqu’elle voyageait avec des hommes, qui, eux, n’avaient qu’à ouvrir leur braguette pour se soulager. Un petit objet également très pratique en hiver lorsque le froid rend presque impensable l’idée d’enlever une couche de vêtements.
Lorsqu’on leur pose une dernière question sur ce que le voyage a changé pour elles en tant que femmes, les réponses varient. L'une admet que cela n’a pas fondamentalement changé sa vie, mais qu’elle adore voyager seule - c’est un moment rien qu’à elle. Une autre souligne qu’en duo comme en solitaire, elle n’était jamais vraiment perçue pour elle-même. Elle raconte qu’en voyage avec des hommes, les gens interagissaient systématiquement avec son binôme masculin. Elle était la “soeur de”, “la copine de”. En partant seule, elle pensait s’affranchir de cette invisibilisation, mais les questions sur son statut ont persisté. “On m’a inventé des vies”, raconte-t-elle, “j’étais veuve, j’avais perdu un enfant et je faisais ce voyage pour combler mon chagrin…” Si à l’annonce de cette anecdote, les rires ont fusé, cela montre que si les mentalités évoluent, la patriarcat reste bien ancré. Comme si une femme ne pouvait voyager seule parce qu’elle le voulait, pour son propre plaisir. Une troisième explique que voyager seule lui a surtout appris à mieux se connaître, à prendre confiance en elle et en ses capacités. Voyager seul·e permet de se recentrer, d’écouter ses envies, de répondre à ses besoins, et surtout de se donner le temps de réfléchir à tout cela.
La journée touche à sa fin. Je quitte le festival avec l’impression d’avoir entrevu un univers qui m’était jusqu’alors étranger. Après cette journée, une chose me semble évidente : le vélo est une passion intemporelle. Pour certain·es, c’est un mode de vie, pour d’autres, une invitation au voyage. Ce n’était qu’une après-midi, mais elle m’a ouvert des perspectives. Finalement, voyager – à vélo ou autrement – c’est avant tout une aventure humaine, faite d’échanges et d’apprentissages constants.