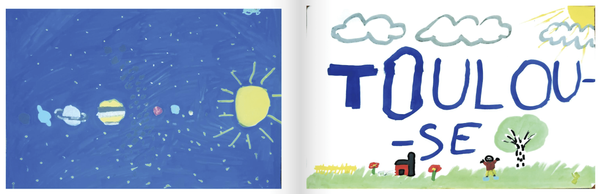L’exceptionnelle longévité de Longo Maï

Salut ! Je suis Martin et j’ai la chance de réaliser un service civique avec Les Chemins de la Transition et la Coopérative Oasis sur le chemin des écolieux à vélo. Je termine mes études d’ingénierie au cours desquelles j’ai pu découvrir et explorer le mouvement low-tech qui m’inspire beaucoup, notamment autour des questions d’autonomie et d’organisations sociales.
Mes jambes et mon vélo m’ont permis de traverser le sud-est de la France et de relier Toulouse à Limans dans les Alpes-de-Haute-Provence, pour rejoindre la coopérative Grange Neuve de Longo Maï. J’y ai passé 4 semaines et l’expérience a été très marquante. Je souhaitais découvrir ce lieu car j’avais eu écho de ses caractéristiques uniques.
Cette coopérative d’inspiration libertaire est la plus vieille de la dizaine de coopératives qui existent en Europe (Suisse, Allemagne, Autriche, Roumanie, Ukraine). Elle a plus de 50 ans !
Depuis le début, des dizaines de personnes y habitent en faisant vivre une diversité impressionnante d’activités pour l’autoconsommation et la vente de certains produits. On y retrouve des moutons, chèvres, chevaux, ânes, poules et de nombreux espaces dédiés au maraîchage, aux vergers, aux céréales, aux forêts, entretenus pour une certaine partie par les chevaux de trait. Tout cela leur permet notamment de produire leur farine, bois de chauffage, tofu, huile d’olive, semences, laine, viande, confitures, conserves, fromage… Et c’est sans parler des herbes médicinales, menuiserie, garage, boulangerie, atelier métal, électrification des vélos, actions politiques ou Radio Zinzine, et j’en oublie !
Mais quelles sont les particularités de ce collectif qui ont permis de mettre en place autant de choses et de perdurer pendant plus d’un demi-siècle ? J’ai recueilli quelques éléments de réponse en discutant avec Pierre et Aspen, ici depuis moins de 10 ans et avec Tyne et Alex, arrivés à la naissance du lieu, encore adolescents à l’époque.
(Certains noms ont été modifiés sur demande des personnes concernées)

Les engagements au centre du projet
Tout d’abord, il convient de savoir comment prend racine cette initiative. Elle est née en 1973 de deux groupes politiques étudiants : Hydra, un groupe communiste autrichien et Spartakus, un syndicat anarchiste suisse. Parmi les idées portées par ces groupes, la lutte des classes, l’internationalisme, l’autonomie, l’anti-fascisme sont particulièrement importantes. Cela les amène à prendre part dans beaucoup d’actions de solidarité dans le monde.
Tyne me parle de de membres de la communauté retournés en Suisse pour accueillir des personnes réfugiées chiliennes suite au coup d’État de Pinochet en 1973, alors même que la coopérative à Limans n’était encore qu’un ensemble de hameaux en ruines et que tout restait à construire. Plus récemment, lors de l’invasion en Ukraine, les membres de Longo Maï ont profité de la présence du réseau dans le pays (avec leur coopérative Zeleny Hay) pour aider à la prise en charge de réfugiés et la fourniture d’aide humanitaire.
Alex m’explique aussi que Longo Maï participe à un réseau de conservation et d’échange de semences, dont des membres vivent et cultivent dans la plaine de Bekaa au Liban. Ce réseau s’étend à la Syrie, Palestine, Iran, Irak et Égypte pour améliorer la souveraineté alimentaire.
Pour Tyne, ces engagements font partie des raisons principales de la pérennité de Longo Maï : « Quand tu ne restes pas replié sur ton nombril, cela aide à dépasser des conflits internes, cela permet de rester soudé en tant que groupe. Tu as un but qui est plus grand que ta petite vie quotidienne. » Alex invite à ne pas idéaliser les engagements politiques qui peuvent être chronophages, pas toujours constructifs et engendrer des réactions qui ne sont pas anticipées. Mais il me dit aussi : « On perd du terrain si on n’a pas à cœur de défendre ce choix », ce choix de construire un collectif de vie et d’activité pour faire émerger des alternatives.
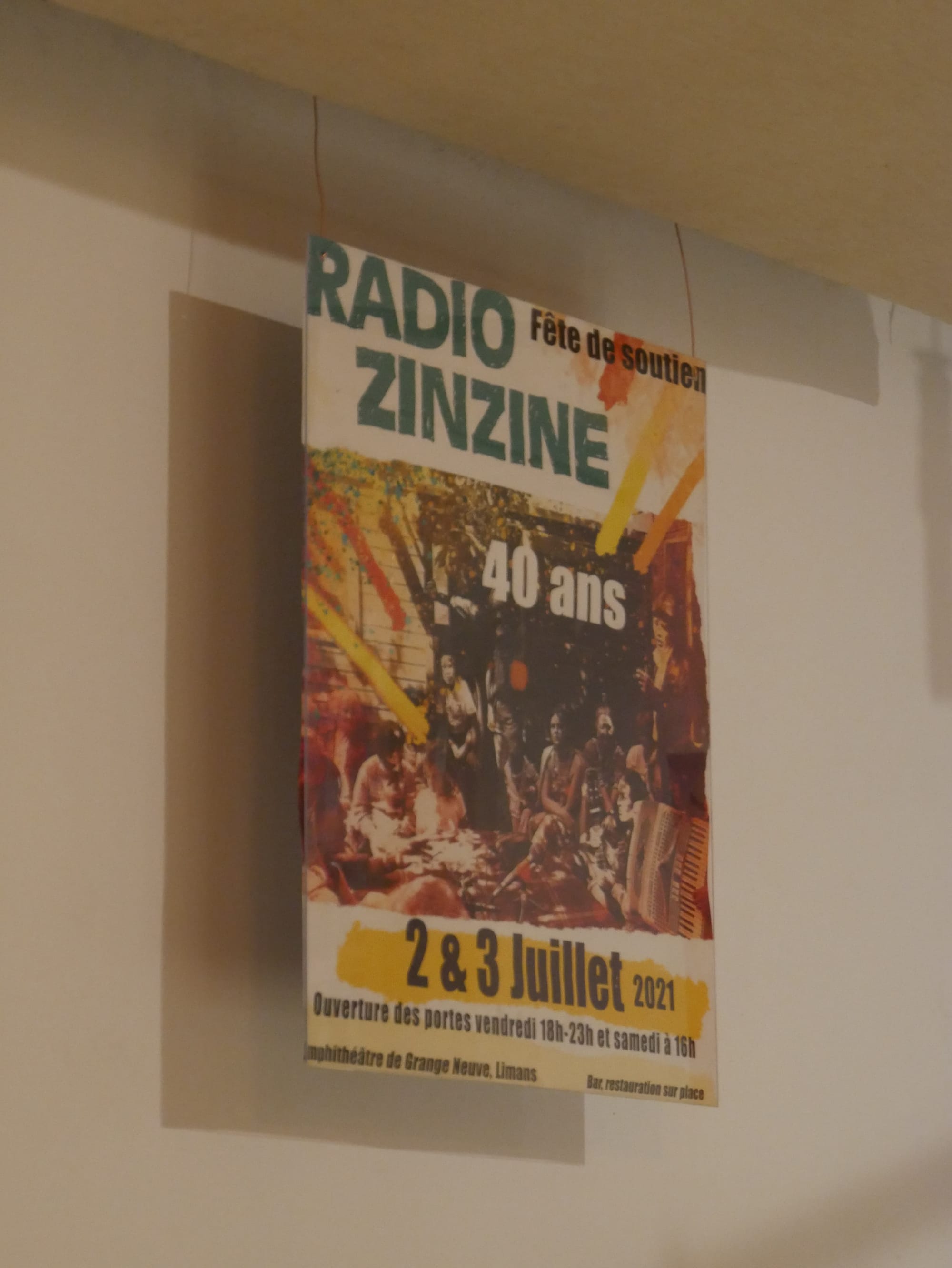
Se positionner dans le temps et dans l’espace
Dans un lieu où quasiment 100 personnes cohabitent et produisent une partie significative de ce qu’elles consomment, il est légitime d’imaginer un isolement par rapport à la société. Pourtant, c’est la sensation inverse que j’ai eu lors de mon passage là-bas.
Déjà, cette ouverture passe par les actions internationales mentionnées plus haut et par la proximité avec les réseaux militants. Ensuite, beaucoup d’habitants et d’habitantes vont passer quelques semaines ou mois dans les autres coopératives de Longo Maï en France et en Europe, ce qui m’a donné un aperçu très dynamique de la coopérative.
Aspen me fait aussi remarquer que la grande antenne de la Radio Zinzine perchée en haut de la colline permet d’entretenir une excellente interface avec l’extérieur. Cette radio libre, créée au moment de la libération des ondes en 1981, les amène à se nourrir de ce qu’il se passe à l’extérieur. J’ai pu ressentir cela directement avec les nombreux journaux étalés sur les tables des espaces communs et avec les invités de la radio que j’ai aperçus au dîner le soir. Aussi, cela leur permet de partager leurs questionnements et leur vision du monde enrichis par cette expérience de vie hors normes.
Alex me dit : « Le développement d’un projet en tant que tel ne suffit pas à faire sens. Il faut se positionner dans le temps et dans l’espace. C’est aussi en relation avec ce qu’il se passe dans le monde que l’on se positionne.»

Une économie qui ne repose pas sur la production
Il convient de préciser la situation économique de Longo Maï qui est unique en son genre. Alors qu’une partie des revenus de l’association provient de la vente de leur production (de vêtements en laine, de conserves…), une autre partie est collectée auprès de donateurs notamment grâce au fait que Longo Maï est d’utilité publique en Suisse. Les dons sont recueillis au sein de la fondation Pro Longo Maï, qui est propriétaire des terrains des coopératives.
Tyne me raconte l’important travail avec les juristes pour sortir des propriétés individuelles et trouver une forme juridique qui soit « inaliénable ». Grâce à cela entre autres, les personnes qui s’installent à la coopérative de Grange Neuve n’ont pas d’argent à investir. Les habitantes et habitants n’ont pas de salaire versé par la coopérative ou de travail à côté, chaque personne reçoit 70€ d’argent de poche mensuel et a accès à tout ce qui est mis en commun. S’il y a des besoins ponctuels plus importants, une demande de budget doit être explicitée à la coopérative, qui est la plupart du temps acceptée.

Une forte dépendance à la communauté ?
Ce fonctionnement permet de sortir de la logique de salariat et se passe donc de certaines aides sociales associées. Tous les avantages qu’offre le mode de vie collectif à Grange Neuve permettent de pallier cela, mais qu’en est-il si une personne décide de quitter la communauté ? Cela est arrivé plusieurs fois et dans la mesure du possible, Longo Maï accompagne cette personne dans son changement de mode de vie, mais comme le dit Tyne « Ce n’est pas un droit, ce n’est pas dans les statuts ».
Pierre me dit que dans tous les cas « On ne te jette pas à la rue ». Cela questionne sur la dépendance vis à vis de la communauté qui est engendrée. Pierre a passé du temps dans d’autres lieux de vie en collectifs en France et il a ressenti que la dépendance pouvait être plus importante dans certains écolieux, organisés autour d’une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Commun) où les personnes qui y habitent achètent des parts du lieu. Certaines personnes sur le départ pouvaient attendre longtemps avant de se faire racheter leurs parts car cela suppose que de nouvelles personnes rejoignent le collectif. Pierre a la sensation que Longo Maï offre surtout beaucoup de libertés car la vie n’y coûte pas grand-chose.

Un mode de consommation en rupture radicale
C’est peut-être d’ailleurs un des grands avantages permis par ce mode de vie : remettre en question profondément son rapport à la consommation ? Avec le fonctionnement de budget que je mentionnais plus haut, Aspen me témoigne que cela implique de « planifier ses dépenses et il y a donc moins de spontanéité dans la consommation ».
La sortie du salariat permet aussi de sortir de la logique « Tout travail mérite salaire ». Plus généralement, un collectif d’une centaine de personnes permet de mutualiser les outils à grande échelle, même si ce n’est pas toujours au niveau de l’ensemble de la coopérative. Pierre me parle par exemple des voitures et des ordinateurs collectifs qui sont très intéressants à mutualiser. « Même si ce n’est pas structurel et imposé, cela permet aux gens qui veulent vivre sans ordinateur, téléphone ou voiture personnelle de le faire. Dans d’autres endroits, tu n’as pas le choix ». Le partage de ces outils me paraît être un bon levier pour sortir de la logique de responsabilité individuelle, des petits gestes.
Alex et Aspen m’expliquent par contre que le collectif permet plus difficilement de voir l’impact de sa consommation individuelle, certaines actions sont diluées dans le collectif. Ces auto-critiques montrent leur remise en question permanente, qui a probablement favorisé cet impressionnant travail de déconstruction de la logique consumériste.

L’enjeu d’être accessible
Le fonctionnement économique et tous les éléments mutualisés permettent d’être plutôt inclusif dans l’accueil de nouvelles personnes au sein de la coopérative, surtout que l’argent n’est pas une condition à l’installation. De par l’histoire de la coopérative et la proximité toujours importante avec les mouvements sociaux, la remise en question de ses privilèges et de sa classe sociale est assez centrale. C’est quelque chose qui avait profondément manqué à Pierre lors de son passage dans d’autres lieux de vie en collectif, où il avait senti un entre-soi social bourgeois qui n’était pas questionné.
L’histoire, le fonctionnement et l’engagement de Longo Maï permettent à priori d’ouvrir plus large, même si la diversité sociale pourrait être encore plus importante. Alex me décrit sa sensation que la coopérative peut être très éloignée de certains milieux. Il donne l’exemple des personnes qui travaillent en usine, de celles et ceux qui doivent vivre de leur production ou encore des jeunes de cité. Aspen m’avait aussi dit que malheureusement la coopérative n’est pas un lieu d’accueil inconditionnel, en capacité d’héberger et d’accompagner des personnes en détresse, même si cela arrive tout de même ponctuellement. Rendre Longo Maï plus inclusif est un chemin sans fin, mais cela semble être une préoccupation importante pour ses habitantes et habitants.

Prendre soin pour perdurer
J’ai été vraiment très inspiré par ce passage à la coopérative de Grange Neuve de Longo Maï. J’ai particulièrement aimé le fait que ce collectif se soit construit autour de questionnements sociaux et que les questions d’écologie en ont découlé progressivement, comme l’idée de prendre soin de soi et des autres.
Aujourd’hui, tous les âges se retrouvent au sein de cette coopérative, avec certaines personnes qui sont là depuis le début mais aussi des plus jeunes arrivés au fil des années ou étant nés ici et revenus plus tard. Il se pose donc maintenant la question du soin des personnes âgées. Dans les milieux militants, le soin (particulièrement envers soi-même) est rarement central mais il le devient de plus en plus ici, tout comme plus largement les questions féministes ou d’identité de genre, grâce aux jeunes générations.
Ces dernières années, un travail critique a été initié sur le passé de la coopérative, et plus particulièrement sur les relations de pouvoir, de domination et les violences qui ont pu s’y dérouler. Tout cela permet à Longo Maï de se renouveler et de se remettre en question continuellement, ce qui me paraît essentiel.