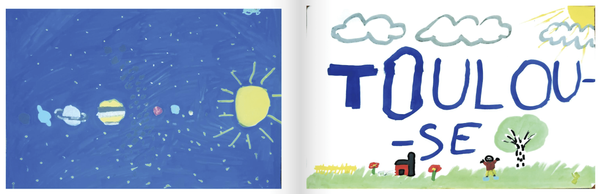Mieux comprendre les monnaies locales
En novembre dernier, j'ai assisté à la 8e rencontre autour des monnaies locales. Cette expérience m'a permis de rencontrer de nombreux acteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS), tous engagés pour promouvoir une économie plus humaine et durable. Cette expérience m’a permis de comprendre plus concrètement l'intérêt de ces monnaies et leur inscription dans l'économie locale. J'aimerais par cet article vous faire part de mes apprentissages.
La monnaie locale complémentaire (MLC), qu’est-ce que c’est ?
Une monnaie locale complémentaire (MLC) est une moyen d’échange utilisé exclusivement sur un territoire donné, qui peut s’étendre de quelques communes à une région entière, ce qui en fait une monnaie profondément ancrée dans le local. Elle repose sur une initiative citoyenne et est gérée de manière démocratique par ses membres : habitants, utilisateurs, entreprises, associations adhérentes et collectivités locales.
Complémentaire à l’euro, la MLC n’a pas pour but de le remplacer. Sa parité simple, où 1 € équivaut à 1 unité de MLC, facilite la conversion. Toutefois, son fonctionnement diffère de celui de l’euro classique. Par exemple, elle ne peut pas être placée en banque et échappe ainsi à la spéculation financière. La MLC se distingue également par des objectifs concrets, tels que le soutien à l’économie locale et la promotion d’un développement durable et solidaire.
Pourquoi utiliser une monnaie locale complémentaire ?
Les monnaies locales complémentaires (MLC) sont des outils qui renforcent l’économie locale en incitant à consommer auprès des commerces et producteurs du territoire. Ces monnaies, circulant uniquement dans un réseau défini, limitent la fuite de capitaux vers les grandes chaînes ou plateformes en ligne, tout en favorisant les circuits courts. Ainsi pour 100€ échangés en monnaie locale, c’est 100 unités de MLC qui circulent sur ce même territoire et l'enrichissent.
En plus de dynamiser l’économie locale, elles renforcent les liens sociaux en créant une communauté engagée autour de valeurs communes (localisme, solidarité, écologie etc.) .
Utiliser une monnaie locale permet également de financer des projets responsables sur son territoire. En effet, les euros échangés contre des unités de MLC sont placés sur un fonds de garantie auprès de banques éthiques et permettent de financer de manière transparente des projets responsables. Plus concrètement, un grand nombre de MLC sont en partenariat avec la NEF, qui s’engage à financer des projets à hauteur du montant du fonds de garantie multiplié par deux. Ainsi pour 100€ échangés en monnaie locale, 200€ sont prêtées par la NEF à des initiatives écologiques, sociales et solidaires du territoire.
Utiliser une MLC permet aussi de repenser notre rapport à l’argent. Elle invite les citoyens à considérer leur argent non seulement comme un moyen d’échange, mais aussi comme un levier pour soutenir des valeurs et des projets locaux. Ce geste, en apparence simple, amène à réfléchir sur les impacts économiques, sociaux et écologiques de nos choix financiers. Les MLC permettent ainsi une réappropriation de la monnaie par les citoyens et une sensibilisation aux enjeux économiques.
Enjeux d'inclusion et de développement pour le futur des monnaies locales
Les monnaies locales complémentaires (MLC) jouent un rôle croissant dans les dynamiques territoriales et économiques, bien qu’elles représentent une infime partie des échanges marchands.
En 2014, la loi relative à l'Économie Sociale et Solidaire (ESS), dite aussi loi Hamon, leur confère un statut légal. Cette reconnaissance a permis aux MLC de passer d'un rôle marginal à celui d'un outil puissant pour favoriser la relocalisation de l'économie et renforcer les liens entre les acteurs locaux. Les MLC s'inscrivent dans une réflexion plus vaste sur le rôle des territoires comme échelons cruciaux pour rapprocher les individus de leur destinée collective. Elles incarnent des « utopies concrètes », offrant un terrain fertile au développement des solidarités et des transferts territoriaux.
Depuis 10 ans, des monnaies locales ont émergé partout en France, avec près de 82 initiatives recensées à ce jour. Créé en 2005, le mouvement Sol fédère bon nombre d’entre elles. Il favorise la cohésion et la coordination entre les différents acteurs, tout en jouant un rôle clé dans le plaidoyer en faveur de ces initiatives à l’échelle nationale notamment.
Aujourd’hui, bien que les monnaies locales soient de plus en plus visibilisées et reconnues par les pouvoirs publics, elles doivent surmonter des défis majeurs pour pleinement déployer leur potentiel. Plusieurs obstacles freinent encore leur expansion, notamment des barrières institutionnelles et des limites réglementaires. À mesure que ces monnaies gagnent en popularité, il devient crucial de déterminer l’échelle d'action la plus pertinente (locale, départementale, régionale) et d'imaginer des modes de gouvernance innovants et inclusifs.
Réfléchir à l’inclusion des citoyens est d’autant plus nécessaire que les MLC peinent encore à dépasser l’image de « monnaies de bobos » et à se démocratiser, malgré des efforts pour élargir leur portée. Leur adoption reste limitée, en partie parce qu'elles doivent encore convaincre une plus grande diversité d’utilisateurs. Il est donc essentiel de les rendre plus accessibles et attrayantes/désirables, au-delà des cercles déjà sensibilisés aux enjeux sociaux et environnementaux. En s’adaptant à la diversité des utilisateurs, ces monnaies pourraient renforcer leur légitimité et leur impact à une échelle plus large.
En conclusion, les monnaies locales complémentaires invitent à repenser les modèles économiques traditionnels et les dynamiques de gestion territoriale. Elles incarnent une véritable alternative pour renforcer la participation collective et reconnecter les citoyens entre eux et à leurs territoires. Elles offrent des pistes vers une économie plus humaine et ancrée localement, même si leur chemin est souvent semé d'embûches.