Semaine de chantier et de réflexion dans une ferme collective
Bonjour, je m’appelle Jade et je suis en service civique avec la Coopérative Oasis et Les Chemins de la Transition. Ma mission consiste à faire un tour de France des écolieux pour colporter ce qui s’y passe, tout en apprenant.
Après mon séjour chez les Habitées, j’ai pu visiter un second lieu dans les Cévennes grâce à une personne investie dans le projet des Habitées et qui vit dans cette ferme collective. Souvent, un lieu en cache un autre, et j’ai l’impression que je pourrais voyager sans m’arrêter, d’un point A à un point B, en allant d’un lieu en transition à l’autre, simplement grâce aux recommandations et aux connexions inter-lieux.
Les habitantes préfèrent rester anonymes, donc je ne donnerai ni le nom du lieu ni sa localisation. Je ne sais pas pourquoi, mais je me retrouve toujours à visiter des endroits où les gens veulent rester cachés. Pas très pratique pour écrire des articles ! Encore une fois, c’est un lieu qui n’appartient à personne… enfin, si : c’est Terre de Liens qui en est propriétaire. Les habitants ont obtenu un bail emphytéotique d’une durée de 30 ans. C’est-à-dire qu’ils sont locataires, mais avec tous les droits d’un propriétaire. Ce détail m’a donné envie de réexaminer mon rapport à la notion de propriété.
Aujourd’hui, je vais essayer de vous proposer un article un peu différent, en vous faisant un rapide débriefing du lieu, puis en partageant quelques réflexions personnelles que j’ai pu avoir sur place.

Un village à part entière
C’est une ferme collective où vivent une quinzaine d’humains, dont des enfants, ainsi que des chèvres, deux ânes, des poules, des paons, des chiens, des chats, des oies et des dindons. Le tout sur une trentaine d’hectares de terrain, situé en montagne et composé de différents espaces.
Il y a un peu tout ce qu’il faut :
- Une grande châtaigneraie collective avec une grande cuisine et un salon commun,
- Deux dortoirs, une salle de pratique, une bibliothèque,
- Une dizaine d’habitats légers,
- Un jardin de petits fruits, de plantes médicinales et de fruitiers,
- Un potager légumier,
- Une prairie, un poulailler, une chèvrerie,
- Un laboratoire, une forge, un four à céramique, des serres,
- Plusieurs ruisseaux.

Accueil
Lors de mon séjour, j’ai été très bien accueillie avec une soirée pizza au feu de bois et bière artisanale. Les gens étaient chaleureux et nous avons eu de bons échanges. J’ai ressenti la simplicité d’un accueil inconditionnel.
J’ai logé dans une yourte avec des baies vitrées et une vue magnifique sur les montagnes. C’est toujours un plaisir de redécouvrir un ciel étoilé après un séjour en ville, où la pollution lumineuse empêche de les voir. J’ai tellement bien dormi dans cette yourte… Je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais j’ai l’impression de mieux dormir dans les habitats légers. J’ai retrouvé la douceur d’un espace sans ondes électromagnétiques et la simplicité de la chaleur d’un poêle à bois.
Les habitants n’ont ni la volonté ni la vocation de devenir un lieu d’accueil. C’est avant tout un lieu de vie et de travail. Bien qu’ils entretiennent de nombreux liens avec l’extérieur, ils ne souhaitent pas s’ouvrir au grand public mais préfèrent recevoir la visite de connaissances, de voisins ou d’amis.

Les activités du lieu
Comme me disait Ambre : « C’est un grand terrain de jeu et il y a beaucoup de joueurs, alors les activités sont nombreuses. »
- Production de fromage de chèvre
- Maraîchage et arbres fruitiers
- Confitures, crèmes de marrons
- Fabrication de bière artisanale
- Glanage de plantes sauvages, tisanes, hydrolats
- Boulangerie (un voisin vient cuire son pain dans leur four)
- Céramique, atelier poterie
- Vannerie, taillanderie, bûcheronnage
- Et mille autres choses que j’oublie.

Les activités de la semaine de chantier
Il s’agissait d’une semaine de nettoyage, d’organisation et de réparation pour préparer la saison.
J’ai participé à plusieurs tâches :
- Ramener et stocker du bois,
- Débroussailler des chemins,
- Désherber,
- Cuisiner pour le collectif,
- Planter un arbre,
- Réparer et poser des clôtures, en utilisant un outil que je ne connaissais pas : la barre à mine !

Le détail qui tue
Une personne proche du collectif, mais qui ne vit pas sur place, réalise du miso maison et de la sauce shoyu à base de pois chiches fermentés. Je n’en avais jamais entendu parler ! Je ne savais pas qu’on pouvait obtenir une sauce au goût similaire à la sauce soja traditionnelle avec des pois chiches. Il devait m’envoyer un manuel explicatif, mais je ne l’ai pas encore reçu. Grande consommatrice de sauce soja, il me tarde d’en savoir plus. Il s’agirait peut-être d’une révélation qui pourrait bien changer le cours de mon existence…

Réflexion sur la création de céramique
Lors d’un repas, j’ai eu une discussion marquante avec une des habitantes au sujet de la céramique. Elle faisait de la céramique puis a arrêté, car elle ne voyait plus de cohérence dans la production d’objets utilitaires. C’est vrai qu’il y en a déjà tellement, nous avons des assiettes, des bols, des tasses pour les décennies à venir. Cuire de la céramique est très exigeant énergétiquement, que ce soit cuit au bois, à l’électrique ou au gaz. Certains diront que c’est différent de boire dans un bol de potier qu’on connaît plutôt que dans un bol produit en usine. Certes, et je suis carrément d’accord.
Le fait est que je pense qu’en général, les céramistes, les potiers, sont des gens qui ont un rapport au vivant et à l’écologie présent, et même s’ils utilisent des émaux naturels : à base de cendre, terre de récolte, etc. C’est comme si l’impact carbone qu’ils généraient s’annulait complètement parce que l’artisanat, c’est vert. Mais non. Ça reste polluant. C’est pour ça que le choix de cette personne a été plus tard de se former à la fabrication d’enduits en terre crue, puis au maraîchage, dans le but d’être plus cohérente avec ses valeurs.
Pratiquant moi-même la céramique, ce sont des questions que je me pose et j’ai l’impression que c’est un peu un sujet sensible.
Par exemple, à l’ENSA Limoges, l’école d’art où j’étudie, la céramique est un point central de l’école, lié à l’histoire porcelainière de la ville. L’école met l’accent sur l’écologie, mais la question de l’impact écologique de la céramique en tant que tel n’est jamais questionnée. Une sorte de greenwashing. L’écologie, c’est très tendance dans le milieu de l’art contemporain. Il y a beaucoup de pratiques très polluantes enrobées de vert.

Réflexion sur l’élevage
C’était beau de voir les enfants déambuler dans la chèvrerie, donner le biberon aux chevreaux. Les chevreaux grimper sur le dos des enfants. Autour du cou des chevreaux, une rondelle en caoutchouc de bocal avec leurs noms écrits dessus. Les femelles sont nommées, mais pas les mâles qui vont être tués. J’étais là le jour de la tuerie, mais je n’y ai pas assisté. Je crois que je débroussaillais des ronces. C’est super qu’ils consomment la viande produite sur leurs terrains, ça leur fait une grande économie. C’est local, je trouve ça noble pour des mangeurs de viande. Mais moi, je me range du côté des enfants et je ne pourrais pas avaler la viande d’un chevreau que j’ai vu gambader.
J’ai réfléchi sur la création de fromage de chèvre, j’ai pu questionner encore une fois mon rapport à l’élevage. J’en discutais avec une autre visitante, elle me disait : « Ici, c’est les meilleures conditions pour les chèvres possibles. » C’est vrai, elles vont paître toute la journée, elles sont libres, elles broutent les collines… Mais la machine à traire quand même. Je revois l’une d’entre elles essayer d’enlever avec sa patte la tireuse enrobant et pompant les mamelles, qui passe dans un tube pour finalement atterrir dans une sorte d’aspirateur… Je ne sais pas, pour moi, c’est dissonant. Peut-être que ça me semblerait plus cohérent si la traite se faisait à la main ? Je ne sais pas… C’est beaucoup de souffrance pour manger du fromage. Et j’ai l’impression que pour tout le travail que ça demande, le maraîchage, niveau temps/gain, est plus rentable en termes de productivité, mais la production de fromage est l’activité de la ferme qui rapporte le plus.

Réflexion sur l’agroforesterie
Hier, à Cieux, en Nouvelle-Aquitaine, j’ai pu assister à une conférence de Geneviève Michon, une ethnobotaniste et ethno-écologue : « L’agriculture de demain sera agroforestière ou ne sera pas. »
Et cette conférence m’a donné une nouvelle vision de l’élevage et m’a permis de donner quelques réponses aux questionnements qui me titillaient lorsque j’étais à la ferme.
Geneviève Michon nous a beaucoup parlé de cohabitation cultures/élevages, de jardins-forêts tempérés et, tout simplement, de l’importance des arbres. Elle a d’ailleurs écrit un livre à ce sujet : Agriculteurs à l’ombre des forêts du monde, paru chez Actes Sud en 2015.
Puis, à la fin de la conférence, les organisateurs ont donné la parole à Éric Germond, éleveur bovin bio à Chabanais, qui a représenté la Nouvelle-Aquitaine au concours général agricole, dans la catégorie agroforesterie, et qui en a remporté le premier prix. Pour l’anecdote, il portait un tee-shirt : « Éric, agriculteur libre et heureux. » Il brillait d’un rayonnement particulier, celui d’un homme qui a réussi sa vie.
Tout souriant, il nous a expliqué comment, depuis 2003, il avait complètement changé sa façon de faire et tout réappris en créant des forêts-paysannes et comment l’agroforesterie lui avait permis de passer de 30 000 euros de charges (foin, médicaments, engrais pétrochimiques, graines, etc.) à 1 800 euros par an en variant et plantant la nourriture de ses vaches limousines. Il nous a aussi dit qu’ils échangeaient beaucoup de connaissances avec d’autres agriculteurs et que ces savoirs paysans, issus de l’intelligence collective, sont essentiels.
Après, une personne dans la salle, un éleveur j’imagine, prit la parole pour dire qu’il y a beaucoup de gens pour expliquer aux agriculteurs comment faire et les juger, mais plus personne ne voulait reprendre le boulot… C’est vrai que les passations sont compliquées. Mais devoir reprendre 100 hectares de ferme tout seul et faire un crédit pour être surchargé de travail, sous-payé, ça ne donne pas très envie. Cela me fait penser que j’ai aussi recroisé une autre personne cette semaine, qui est en cours de passation avec un éleveur pour un terrain d’une centaine d’hectares et qui essaye de former un collectif pour reprendre l’exploitation.
C’est à nous de jouer pour continuer à explorer ces nouvelles façons de faire et trouver des solutions pour être heureux, agir au plus juste, pour tenter de vivre autant que possible en harmonie et en faveur de toutes les formes de vie.

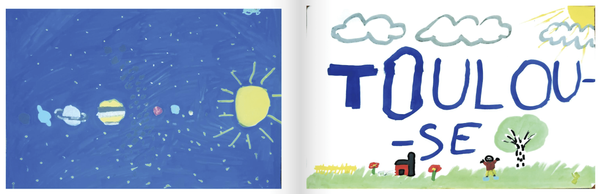

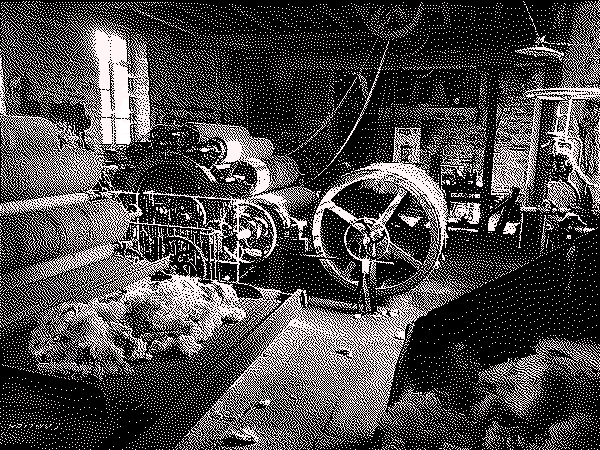
![[vidéo] Ferme de Trutt](/content/images/size/w600/2025/05/WhatsApp-Image-2025-01-29-at-16.45.32.jpeg)
